proposée par Marc
Rentrée 1963, Saint-Exupéry nous tombe du ciel : nous inaugurons un lycée tout neuf. Ce jour-là, l’été joue les prolongations à la Croix-Rousse : le ciel est tout bleu, transparent, une petite brise fraîche nous met l’espoir au cœur.
nous tombe du ciel : nous inaugurons un lycée tout neuf. Ce jour-là, l’été joue les prolongations à la Croix-Rousse : le ciel est tout bleu, transparent, une petite brise fraîche nous met l’espoir au cœur.
Nous, les élèves de la classe de philo, qui essayons de trouver nos marques dans le nouvel édifice, construit selon la mode architecturale dernier cri de ces années-là. Trop grand. Il est trop grand, pour des potaches qui avaient été habitués à vivre à l’étroit quatre années durant dans les préfabriqués du Clos-Jouve.
 Tout en longueur. Bizarre, pour nous qui avions ensuite tenté d’apprivoiser, au cours des deux années précédentes, les proportions de cathédrale et les hautes fenêtres du lycée Neyret. Trop lumineux aussi, pour les dormeurs mal réveillés de l’enfance que nous sommes encore. Les couloirs étaient interminables. Le carrelage à foison. Rien ou presque dans la construction n’était de bois ni de pierre : béton, verre, acier, plastique.
Tout en longueur. Bizarre, pour nous qui avions ensuite tenté d’apprivoiser, au cours des deux années précédentes, les proportions de cathédrale et les hautes fenêtres du lycée Neyret. Trop lumineux aussi, pour les dormeurs mal réveillés de l’enfance que nous sommes encore. Les couloirs étaient interminables. Le carrelage à foison. Rien ou presque dans la construction n’était de bois ni de pierre : béton, verre, acier, plastique.
Nous avons pris possession de notre nouveau bahut – tellement nouveau qu’il en aurait senti le bébé, en tout cas la peinture, c’est sûr, qui monte à la tête… Et je crois bien que nous n’avons rien dit, rien commenté. Nous nous sommes posés là, assemblés par petits morceaux, par tout petits groupes, dans l’immense cour de bitume. Et tout était impeccable. Nous sommes restés interdits, nous qui avions baigné dans le foutoir poussiéreux du Clos Jouve, avant d’arpenter quelques années après les volées de pierre remplies d’échos des escaliers du lycée Neyret, lentement martelées dans un sens, dévalées dans l’autre. Une cathédrale peuplée de pupitres, noirs comme la nuit.
Ici, à Saint-Ex, tout était neuf, tout était propre, rien ne serait probablement très drôle, mais tout serait strict. Ce n’était pas vraiment, malgré toutes ces coursives, que nous nous sentions comme en prison. Nous avions plutôt l’impression d’être… hospitalisés.
Quelle idée aussi, toutes ces peintures claires, hygiénistes, pas un grain de poussière ou de noirceur ; et puis ces alignements parfaits : les innombrables fenêtres toutes semblables, toutes carrées, aussi carrées que, dans les classes, la multitude des petites tables jaunâtres, qui semblaient de carton. Ce lycée tout en longueur ressemblait à un animal couché, une bête un peu trouble, ruminant ses mauvais coups. Même le surgé, qui n’avait pas changé, petit homme barbu et pensif, paraissait ébahi, presque timide. Tout ici fleurait l’irréel, le décalé, le discordant, en phase à cet égard avec nos malaises adolescents…
En classe, c’était Spartacus et les bêtes sauvages. Nous découvrions la philosophie, dont nous n’avions jamais, jamais entendu parler. Sa toute jeune prof, si fluette, avait été lâchée face à trente gars (sans compter les remplaçants), qui sentaient le fauve : leur cage avait connu un retard de livraison. Ici, dans ce lieu suspendu entre ciel et terre, même le prof de gym était bizarre : il avait oublié d’être gras, et lourdaud ; il était mince et sportif (surprise) et vif (re-surprise) ; plutôt petit, toujours en survêt’ bleu roi, de la même taille que la délicate prof de philo, il avait choisi d’en tomber amoureux, nous le savions : Marivaux en salle des profs…, ou le Schtroumpf amoureux de la Brindille… C’était, dans tout ce béton, la seule fleur de poésie qui réussirait à pousser.
Cela a été aussi ma chance dans ce paradis tout neuf qui sentait l’éther : le prof de gym avait appris en conseil de classe que j’étais l’un des rares à être motivé par l’enseignement de la prof de philo ; et il avait fait le choix, plutôt que de me martyriser pendant ses cours, de m’épargner. C’était une sorte d’intellectuel en somme.
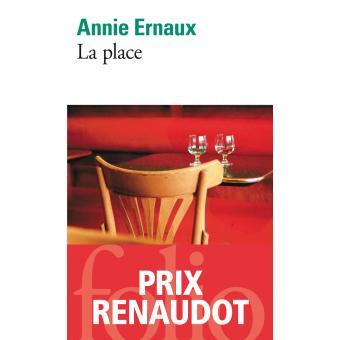
” J’ai passé les épreuves pratiques du Capes2 dans un lycée de Lyon, à la Croix-Rousse. Un lycée neuf, avec des plantes vertes dans la partie réservée à l’administration et au corps enseignant, une bibliothèque au sol en moquette sable. ”
(première phrase du livre)

Moi aussi, je suis entré en 3e à St-Ex en 63. L’année d’avant, j’avais fait dans la classe de Mr. Rostagnat une “enquête” sur la construction du Lycée et j’ai pu visiter (sans casque!!) l’édifice puis j’en ai fait une maquette. Ce Lycée, pendant mes longues années au Texas, était ma madeleine de Proust tant il y avait de souvenirs avec les élèves, mais aussi les profs et leurs enfants. Mon plus vieux copain, encore à Lyon lui, c’est à Neyret que l’on s’est connus il y a 60 ans…
Ayant été admis dans cet établissement l’année de son ouverture et l’ayant fréquenté pendant sept ans, jusqu’au baccalauréat, je voudrais rappeler le nom de tous les enseignants que j’ai eus de la classe de sixième à la classe de terminale.
Je précise que ce qui suit n’est pas dû à ma mémoire, qui est loin d’être infaillible, mais à la conservation de mes bulletins scolaires!
En classe de sixième (1963-1964)
Mathématiques: Mr Jourdan
Sciences naturelles: Mr Lagoutte
Histoire & Géographie: Mme Riou
Français: Mr Dupont
Anglais: Mme Fichard
Dessin & Trav. Manu: Mr Chabredier
Musique: Mr Teillière
Education physique: Mr Rougerie
En classe de cinquième (1964-1965)
Mathématiques: Mme Lévy
Sciences naturelles: Mlle Crépet
Histoire & Géographie: Mme Gautier
Français: Mme Goyard
Anglais: Mr Curtet
Dessin & Trav. Manu: Mr Chabredier
Musique: Mme Gasnier puis Mme Gosuier
Education physique: Mr Caluory
En classe de quatrième (1965-1966)
Mathématiques: Mr Mayer
Sciences naturelles: Mme Pattee
Histoire & Géographie: Mr Calvié
Français: Mr Gerbe
Anglais: Mr Dérioz
Allemand: Mr Brachon
Dessin & Trav. Manu: Mr Renoux
Technologie & Dess Indus: Mr Defours puis Mr Bédrossian
Musique: Mme Décaillot
Education physique: Mr Abbat
En classe de troisième (1966-1967)
Mathématiques: Mr Moury
Sciences physiques: Mr Verrière
Histoire & Géographie: Mr Martin
Français: Mr Ducroux
Anglais: Mr Lapalu
Allemand: Mr Brachon
Dessin & Trav. Manu: Mr Jembron ou Jambron ou Jambon
Technologie & Dess Indus: Mr Villeneuve puis Mr Senes
Musique: Mme Décaillot
Education physique: Mr Caluory
En classe de seconde C (1967-1968)
Mathématiques: Mr Guilloux
Sciences physiques: Mme Griantet
Histoire & Géographie: Mr Martin
Français: Mr Pansard
Anglais: Mr Fichard
Allemand: Mr Mondon
Education physique: Mr Prost
En classe de première C (1968-1969)
Mathématiques: Mr Achard
Sciences physiques: Mr Dupont
Histoire & Géographie: Mr Simon
Français: Mr Simon
Anglais: Mr Lenoble
Allemand: Mr Magniu
Education physique: Mr Choffee
En classe de terminale C (1969-1970)
Mathématiques: Mme Grillet
Sciences physiques: Mr Angelié
Sciences naturelles: Mr Lagoutte
Histoire & Géographie: Mr Bonnerue
Philo: Mr Delafaye
Anglais: Mr Fichard
Allemand: Mr Goetz
Education physique: Mr Marin
Cet établissement devait remplacer le lycée Neyret devenu trop petit et trop vétuste. Ainsi que les installations préfabriquées du Clos Jouve.
Saint-Ex était l’équivalent d’un « Lycée-Collège », mais on parlait plutôt d’un Lycée à deux cycles.
Le premier cycle, de la sixième à la troisième avait ses salles de cours situées au premier étage
Le second cycle, de la seconde à la terminale se situait au second étage.
Le troisième étage était encore en travaux en cette rentrée 1963 et allait regrouper entre autres les salles de physique et de chimie.
Le rez-de-chaussée disposait d’un grand espace couvert en bordure duquel se trouvait un grand local de loisir, le « Bar de l’Escadrille » dont l’entrée était ornée par une grande hélice en bois, en hommage à la carrière d’aviateur d’Antoine de Saint-Exupéry.
Le principal, puis proviseur de l’établissement à été pendant toute cette période de sept ans monsieur Laroche.
Le surveillant général, monsieur Percevaux.
Le censeur, monsieur Charle-Aubrun.
J’ai habité 28 ans la Croix-Rousse où je suis né en 1960 et j’ai fréquenté Saint Ex de 1972 à 1979 (après Clément Marot)… mais je connaissais par cœur le lycée bien avant, car mes parents y ont été profs tous les deux (mon père venait de Neyret) et mon frère ainé a lui aussi fréquenté les “baraques” du Clos Jouve car nous habitions à un jet de pierres ! Moi aussi j’ai connu de près ou de loin à St Ex les Laroche proviseur, Perceveaux alias Paupaul le surgé, les Goetz mari et femme tous deux profs d’allemand, les Loubat et Visse profs de lettres, Guy prof de maths, Rostagnat prof d’histoire-géo, Lagoutte prof de sciences naturelles… et j’en passe. Que de souvenirs croix-roussiens et si lointains !
En 1964/1965, déjà les mêmes noms et d’autres bien sûr. Après le bac 3 ans de pionicat, j’y ai rencontré JM Aulas, déjà chef de bande, et d’autres qui ont laissé leur nom dans les chroniques lyonnaises. Les petits enfants ont pris la suite, toujours fidèles à la Croix Rousse…
J’ai connu la même rentrée inaugurale avec les même profs et Percevaux qu’on appelait Paupaul. Et Jean Colombel super prof de français latin. Il n’y avait pas encore de piscine et les épreuves d’endurance se déroulaient en dehors, faute de piste.
Colombel qui paraissait d’une prétention sans égale, au bout de son cigarillo…
J’ai également fait la rentrée en 1963 en 4ème, après deux ans de clos Jouve. Me reviennent quelques noms : Perceveaux surveillant général, Roche ou Laroche principal, Mr Gerbe professeur de français, Mme Watrin professeur d’anglais, Mr Prost éducation physique… De bons souvenirs !!!
Et Monsieur Goetz : bon prof, qui ne rigolait pas, qui a réussi à nous enseigner pas mal d’allemand ; monsieur Loubat, professeur de français, bien plus moelleux, la cigarette au bec, avec des airs de Marcel Camus ; mademoiselle Maza, toute fluette, très sérieuse et bosseuse prof de philo : elle inaugurait la toute première classe de la section philo, lâchée face à la bande d’orangs-outangs que nous étions (certains faisaient une fois et demie sa taille, en hauteur, pas forcément en tour de tête…) ; et le longiligne monsieur Théière, avec ses airs de Croquignol, devait toujours essayer de nous enseigner la musique, pendant que le très institutionnel monsieur Laroche, le proviseur, faisait des apparitions dans son éternel costume bleu, assisté de son commissaire politique, pardon de son « surgé » : monsieur Perceveaux, bonne pâte dans le civil mais pas pendant le service… ; il nous a accompagné tout au long, de la classe de sixième à la terminale, avec sa bouille encadrée de sa tignasse frisée, ses deux loupes à monture d’écaille en bataille (prof d’histoire géo au départ, il avait même essayé de nous mettre en relation avec les Romains en 5ème, mais ça l’ennuyait et nous aussi…)
Et encore : ce terrible prof de physique en blouse blanche, ami (seulement) des cadors en maths…, qui nous « conviait » à d’épouvantables devoirs sur table… le samedi après-midi, surtout quand il faisait beau…
Bref, bref, bref… Souvenirs, souvenirs, comme eût dit Johnny…
Laroche que ma fille retrouvera Proviseur au Lycée du Parc.