proposée par Marc
C’était un tout petit marchand de journaux, dont la boutique sentait le plastique et les bonbons. Le magasin était vraiment petit et le marchand à peine plus grand. Je me comprends. Il ressemblait à un coiffeur, celui de la rue Ozanam en tout cas, à cause de la brillantine qui plaquait la mèche de cheveux noirs en travers de son crâne, destinée à cacher sa calvitie, celle qui l’enfonçait sans doute un peu plus chaque jour dans sa vie de célibataire. Etait-ce cela qui le rendait ectoplasmique : une sorte de tristesse planante, devenue transparente à force de la grignoter à petits coups, telle une gaufrette de vieille ? Je me comprends. Ce petit homme cérémonieux, cérémonieux et triste, était surtout parfaitement inconscient : il n’avait aucune idée du torrent de passions que son commerce nourrissait, chez nous qui étions encore plus petits que lui – mais à sept ou huit ans, quoi de plus normal.
Cela se passait sans doute le jeudi. Probablement en milieu de matinée.
En entrant, la clochette timide comme une demoiselle avait tinté comme il convient, et je savais parfaitement ce que je venais faire là. Chaque semaine, je me saisissais, au sein d’un présentoir riquiqui et branlant, d’un petit bouquin tout mou et parfaitement inepte : un illustré, comme on disait.
Une semaine sur deux c’était un petit brun râblé, 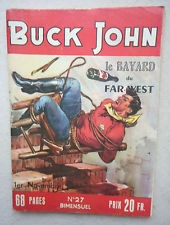 le cheveu gras-mouillé, qui menait la danse. Objectivement il était plutôt vulgaire, brutal et désagréable ; il devait détester la poésie et bien d’autres choses encore. Il n’avait jamais une minute à lui, tellement il avait l’art de se mettre dans des coups fourrés puis de s’en sortir, mais avec quelque peine. C’était un besogneux sans jugeote, mais son six-coups réfléchissait à sa place. Pour le décor, la scénographie… : un bout de crinière, une étincelle criarde lorsqu’un fer du cheval heurte une pierre, un ou deux cactus, et c’était tout. C’était une production à faibles moyens en noir et blanc (beaucoup plus de blanc que de noir), mais quelle tension ! (en fait, c’était le lecteur qui faisait tout le boulot). Ah, oui, j’oubliais : il avait toujours un méchant foulard vissé autour du cou, dont les extrémités flottaient joliment au vent. Le gars s’appelait Buck John (nous disions Buc Jone).
le cheveu gras-mouillé, qui menait la danse. Objectivement il était plutôt vulgaire, brutal et désagréable ; il devait détester la poésie et bien d’autres choses encore. Il n’avait jamais une minute à lui, tellement il avait l’art de se mettre dans des coups fourrés puis de s’en sortir, mais avec quelque peine. C’était un besogneux sans jugeote, mais son six-coups réfléchissait à sa place. Pour le décor, la scénographie… : un bout de crinière, une étincelle criarde lorsqu’un fer du cheval heurte une pierre, un ou deux cactus, et c’était tout. C’était une production à faibles moyens en noir et blanc (beaucoup plus de blanc que de noir), mais quelle tension ! (en fait, c’était le lecteur qui faisait tout le boulot). Ah, oui, j’oubliais : il avait toujours un méchant foulard vissé autour du cou, dont les extrémités flottaient joliment au vent. Le gars s’appelait Buck John (nous disions Buc Jone).
Une semaine sur deux, c’était exactement le même illustré, mais ça n’avait rien à voir. Le décor était toujours aussi pauvre, les “aventures” toujours aussi maigrelettes, et on voyait le jour au travers de tous les personnages. Sauf le héros. Lui, c’était Kit Carson.
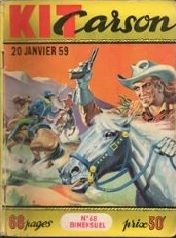 Il avait beau lui arriver les mêmes trucs qu’à Buck, ça n’était pas pareil : silhouette gracieuse, élancée, larges épaules cependant sous sa veste d’éclaireur scout en peau de cerf à franges, il ne quittait jamais ses gants de cuir blanc à manchettes façon mousquetaire, qui ne le gênaient absolument pas pour tirer, à la vitesse de l’éclair systématiquement. Il avait de longs cheveux blonds qui ondulaient en flottant au vent. Il s’y prenait un peu plus en douceur au premier abord avec les malfrats, mais à la fin il en faisait de la pâtée tout comme l’autre, le Buck.
Il avait beau lui arriver les mêmes trucs qu’à Buck, ça n’était pas pareil : silhouette gracieuse, élancée, larges épaules cependant sous sa veste d’éclaireur scout en peau de cerf à franges, il ne quittait jamais ses gants de cuir blanc à manchettes façon mousquetaire, qui ne le gênaient absolument pas pour tirer, à la vitesse de l’éclair systématiquement. Il avait de longs cheveux blonds qui ondulaient en flottant au vent. Il s’y prenait un peu plus en douceur au premier abord avec les malfrats, mais à la fin il en faisait de la pâtée tout comme l’autre, le Buck.
La vie normale en somme, au Far West de la rue de Vauzelles. Notre cœur battait donc alternativement et très fort pour ce petit crasseux de Buck John et pour le Luis Mariano de la pampa. C’était imparable, c’était bien.

Une chose vraiment mystérieuse était que, pendant ce temps-là, ma petite sœur était l’objet d’émotions aussi intenses, avec quelque chose qui n’avait rien à voir – et peut-être même encore un peu moins (je me comprends) – en se plongeant chaque semaine dans Nano et Nanette, lesquels regardaient en chiens de faïence, sur le même présentoir, ce petit crasseux de Buck John et le fringant Kit Carson.
Tout cela, ces émotions, à l’insu bien entendu du petit marchand de journaux, dont la calvitie envoyait des clins d’œil à travers sa mèche maigrelette.
Impéria est un éditeur lyonnais de bande dessinée de 1951 à 1986.
C’est l’un des plus importants éditeurs français de petit format (en 1946, Robert Bagage fonde au 8 rue de Brest à Lyon “Les éditions du Siècle” qui deviennent Impéria en 1951). Il est à noter l’exceptionnelle longévité des revues de l’éditeur avec des titres comme Buck John (613 numéros), Kit Carson (552 numéros).

Nous avons donc pu nous croiser (fin des années 50) !
Mais moi j’avais, dans mon souvenir, toujours affaire à un monsieur un peu mélancolique…
Le jeudi matin nous allions acheter Tintin et Spirou chez la marchande de journaux, madame Picard, rue de Vauzelles.
Mon père trouvait toujours un prétexte pour les lire avant nous !
Kit Carson, Pecos Bill, Buck John… toutes des BD des années 50. Je ne les avais pas, mes parents n’avaient pas les moyens. Heureusement, certains, plus argentés les faisaient suivre. Et elles circulaient, elles circulaient…
Jamais achetées, toujours lues.